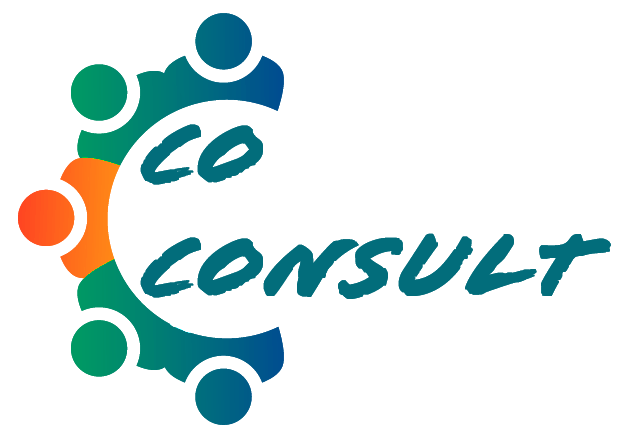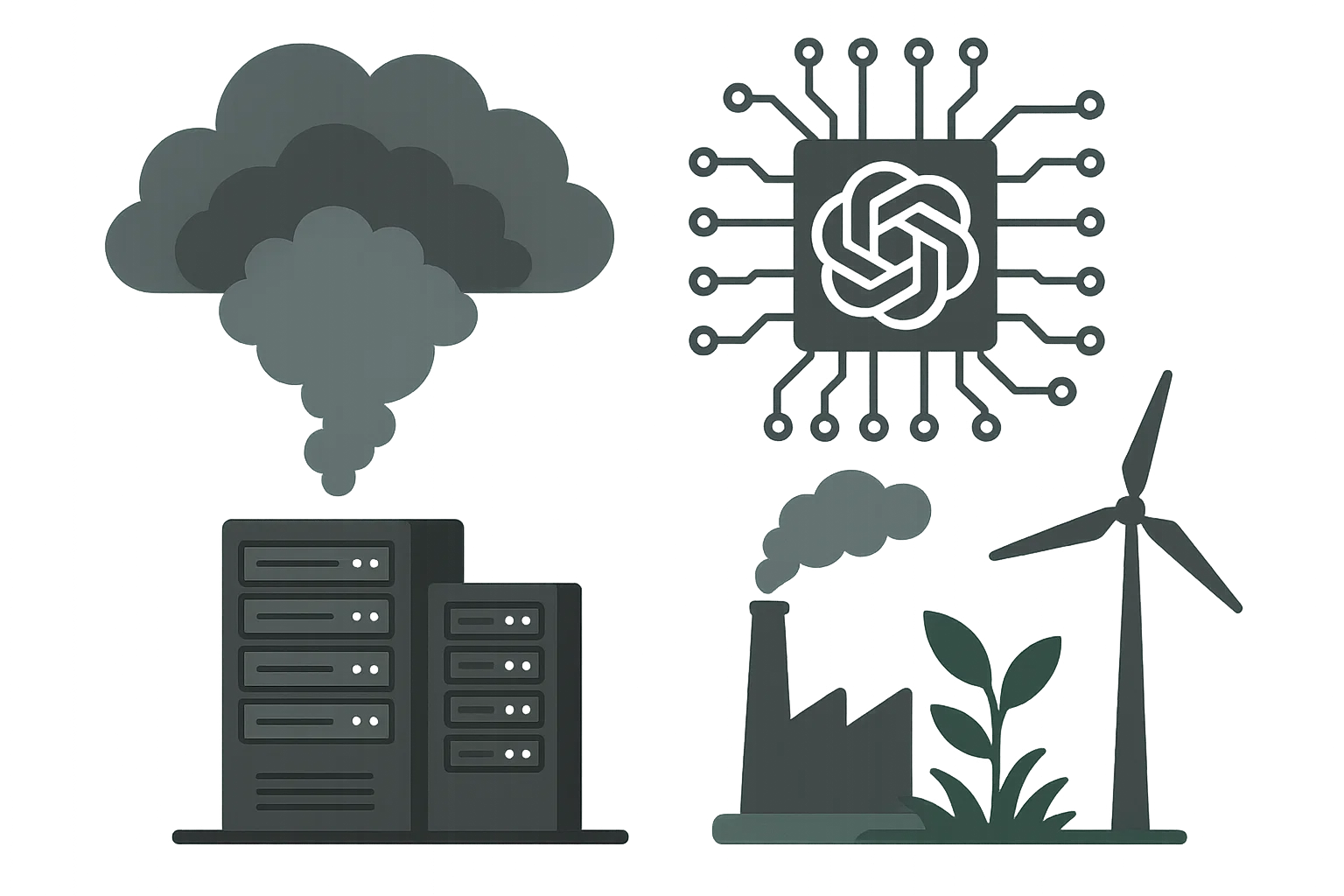L’intelligence artificielle (IA) est aujourd’hui omniprésente : assistants virtuels, outils de traduction, véhicules autonomes ou encore solutions de productivité. Si ses usages apportent des bénéfices considérables, son fonctionnement repose sur des infrastructures numériques énergivores qui soulèvent une question essentielle : quel est l’impact environnemental et carbone de l’IA ?
L’intelligence artificielle : innovation mais forte consommatrice d’énergie
L’IA fonctionne grâce à des algorithmes complexes, souvent alimentés par d’immenses bases de données.
Pour être performants, les modèles doivent être entraînés sur des serveurs puissants, nécessitant :
une consommation électrique élevée,
une capacité de calcul massive,
des data centers climatisés pour éviter la surchauffe.
L’étape d’entraînement des modèles est particulièrement gourmande en ressources : des milliers de processeurs et cartes graphiques fonctionnent en continu, générant une empreinte carbone importante.
ChatGPT : quel est son impact carbone ?
ChatGPT, développé par OpenAI, illustre bien ce défi.
Une requête classique sur l’outil pourrait représenter environ 0,6 kWh d’énergie, soit près de 285 g de CO2, l’équivalent d’un trajet de 2 km en voiture.
À titre de comparaison, une recherche Google émet environ 7 g de CO2.
Cette consommation varie selon :
la complexité de la demande,
la durée de la conversation,
la charge des serveurs au moment de l’utilisation.
Les besoins énergétiques proviennent principalement :
du traitement des données par des GPU haute performance,
de l’alimentation continue des serveurs,
du refroidissement des data centers.
Où sont hébergés les serveurs de ChatGPT ?
ChatGPT repose sur une infrastructure cloud distribuée. OpenAI s’appuie sur des acteurs comme Microsoft Azure, AWS et Google Cloud, qui disposent de centres de données à l’échelle mondiale.
Cette répartition permet de :
réduire la latence pour les utilisateurs,
répartir les charges de calcul,
s’adapter aux réglementations locales.
Cependant, ces infrastructures restent énergivores malgré les efforts d’optimisation.
PUE et efficacité énergétique des géants du cloud
Le Power Usage Effectiveness (PUE) mesure l’efficacité énergétique des data centers.
Microsoft Azure : vise un PUE inférieur à 1,125 (soit plus de 89 % d’efficacité).
Google Cloud : annonce un PUE moyen de 1,12 en 2020.
AWS : ne communique pas ses chiffres, mais affirme travailler sur l’amélioration continue de son efficacité énergétique.
Ces chiffres montrent des progrès, mais la consommation globale reste significative à l’échelle mondiale.
Comment réduire l’impact carbone de l’IA ?
Plusieurs leviers existent pour limiter l’empreinte carbone de l’intelligence artificielle :
Algorithmes plus sobres : concevoir des modèles nécessitant moins de données et de puissance de calcul.
Optimisation matérielle : développer des microprocesseurs moins énergivores.
Infrastructures vertes : alimenter les data centers avec des énergies renouvelables.
Réutilisation des modèles : recycler et adapter des modèles existants plutôt que de tout réentraîner.
Outils de suivi : utiliser des solutions de monitoring carbone pour les services cloud.
L’IA ouvre des perspectives extraordinaires, mais elle doit s’inscrire dans une logique de sobriété numérique. Les entreprises, les chercheurs et les utilisateurs ont un rôle à jouer pour concilier innovation technologique et responsabilité environnementale.
Chez Coconsult, nous suivons de près ces enjeux liés à la pollution numérique et à la durabilité du cloud. Notre ambition est d’accompagner nos clients vers des solutions numériques à la fois performantes et respectueuses de l’environnement.